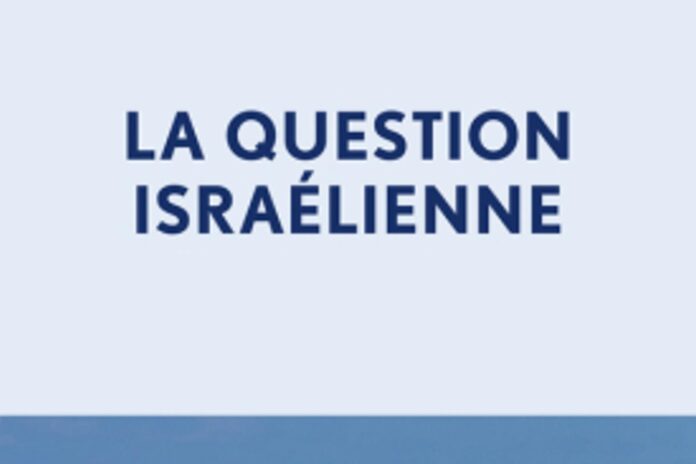A l’aéroport de Tel-Aviv, le tableau « Départs et arrivées » clignote du monde entier. On vient d’Europe, d’Asie, d’Amérique, d’Afrique. La guerre à Gaza a momentanément perturbé cette ouverture au monde, mais, depuis les années 1990, Israël a fait sa place dans la communauté des nations. Longtemps boycotté par le monde arabe, il commence même à sortir de cet isolement régional : l’Egypte, la Jordanie puis, plus récemment, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont établi des relations avec l’Etat hébreu. Demain, ce sera peut-être au tour de l’Arabie saoudite.
Froide ou plus ou moins tiède, la paix avec ces régimes arabes a traversé la tragédie du 7 octobre 2023 et celle des quinze mois de bombardements intensifs sur le territoire palestinien de Gaza. C’est l’un des paradoxes d’Israël : de mieux en mieux accepté dans son environnement arabe quand il s’agit d’Etats, en guerre au coin de la rue face aux Palestiniens. La spirale de violence a atteint un point d’incandescence avec le pogrom barbare perpétré dans le sud d’Israël à l’automne 2023, puis la terrifiante punition collective infligée à la population gazaouie. Un peuple contre un autre sur la même parcelle de terre. Pourquoi ? Comment ? Jusqu’à quand ? Deux ouvrages s’efforcent d’apporter des réponses.
Exercice de didactisme éclairé et éclairant, La Question israélienne, de Bruno Tertrais (L’Observatoire, 172 pages, 20 euros) dresse l’état des lieux. Sur le territoire de l’ancienne Palestine mandataire, la moitié de la population juive mondiale vit aux côtés de la moitié de la population palestinienne mondiale : 6,7 millions de personnes pour chacune des deux communautés. Elles s’affrontent jour après jour – et cela a commencé bien avant la création de l’Etat d’Israël.
Le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique s’attache à soigneusement définir les termes du débat. Le sionisme est le nom pris par le mouvement national juif qui naît dans le bouillonnement de l’éveil européen des nationalités, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, quand une minorité nationale opprimée décide que son émancipation et sa protection passent par la création d’un Etat propre. Pas grand-chose à voir avec le colonialisme. A la maturation du sionisme va correspondre, en parallèle, la naissance d’une conscience nationale palestinienne singulière, distincte des autres nationalismes arabes. Bruno Tertrais retrace ce double cheminement : « Les nations ne sont pas immanentes, écrit-il, elles construisent leur identité progressivement », se renforçant dans l’adversité.
Il vous reste 50.98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.