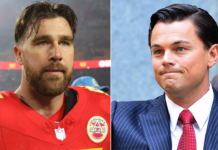Une image pour l’histoire, à défaut d’un cessez-le-feu. La médiation américaine visant à mettre fin à la guerre russe en Ukraine est si tortueuse que la photo des présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky assis face à face sur deux simples chaises de métal doré et de velours rouge, dans la majesté de la basilique Saint-Pierre, juste avant les funérailles du pape François, samedi 26 avril, à Rome, penchés l’un vers l’autre comme dans un dialogue intense, a tenu lieu de message positif pendant tout le week-end.
Cet échange seul à seul n’a même pas duré dix minutes, selon une source ukrainienne, et rien ne permet de dire qu’il a été décisif. « Symbolique », « potentiellement historique », « très belle rencontre » : autant de qualificatifs, utilisés successivement par les deux présidents, qui laissent place à l’espoir, sans pour autant exclure la possibilité de l’échec.
M. Zelensky, cette fois, n’a pas oublié de dire merci au président des Etats-Unis dans son compte rendu sur le réseau social X. L’affront que lui ont infligé Donald Trump et son vice-président, J. D. Vance, le 28 février, dans le bureau Ovale, ne sera jamais complètement lavé, mais au moins le dialogue est-il renoué. Et, signe sans doute que le président ukrainien n’a pas parlé dans le vide samedi, même brièvement, M. Trump a émis des doutes un peu plus tard, dans un commentaire sur son réseau, Truth Social, sur la volonté du président Vladimir Poutine d’arrêter la guerre.

Peut-être « est-il en train de me faire marcher », s’est demandé le président américain avec une candeur qui serait touchante si elle ne concernait pas la vie de soldats et de civils tués chaque semaine dans ce conflit. Dimanche, M. Trump s’est dit « très déçu » que Moscou ait continué à bombarder l’Ukraine malgré les discussions. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, a eu un quatrième entretien avec le président russe, vendredi, au Kremlin.
Pour le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, les efforts américains doivent aboutir dans la semaine qui vient, faute de quoi les Etats-Unis les abandonneront, a-t-il dit, dimanche, sur NBC. Ce n’est pas la première fois qu’il agite cette menace, mais d’une part cette semaine marque les cent premiers jours de la présidence de M. Trump, qu’il aimerait pouvoir couronner d’au moins un succès diplomatique, et d’autre part il existe maintenant deux propositions claires sur lesquelles baser la négociation.
La proposition élaborée par les Américains est largement favorable à la Russie : elle reconnaît de jure l’annexion de la Crimée, occupée par la Russie depuis 2014, et de facto l’emprise de la Russie sur les territoires qu’elle a conquis dans quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine ; elle exclut l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, mais prévoit une « garantie de sécurité solide » relativement vague. La proposition euro-ukrainienne, elle, n’envisage d’aborder les questions de territoire qu’après un cessez-le-feu total et ne mentionne pas de reconnaissance de l’emprise russe. Elle rejette toute limitation des forces armées de l’Ukraine, qui aura le droit d’inviter des troupes alliées à se déployer sur son sol, dans le cadre de solides garanties de sécurité.
Toute la question est de savoir si ces propositions sont conciliables. M. Trump a affirmé au magazine Time que la Russie garderait la Crimée. « Zelensky le comprend », a-t-il ajouté. Rien n’est moins sûr. Pour l’Ukraine comme pour les Européens, reconnaître l’annexion de la Crimée, c’est remettre en cause les fondements de la sécurité en Europe.