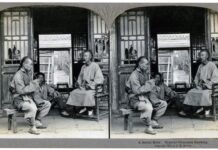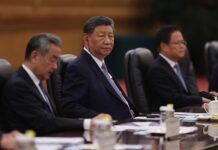Les divisions au sein de l’Union européenne (UE) sur la question israélo-palestinienne se sont une fois de plus étalées au grand jour lors du vote, le 12 septembre, de la « déclaration de New York » par l’Assemblée générale des Nations unies. Ce texte, parrainé par la France et l’Arabie saoudite, se voulait une « feuille de route » en vue de « matérialiser la solution à deux Etats » avec « cessez-le-feu immédiat à Gaza et libération de tous les otages » et « établissement d’un Etat palestinien viable et souverain », dont serait exclu le Hamas.
Au total, 142 Etats ont voté en faveur de ce texte, auquel se sont opposés frontalement les Etats-Unis et Israël, mais aussi huit autres pays, dont la Hongrie. Son premier ministre, Viktor Orban, confirmait ainsi son refus de souscrire désormais au soutien pourtant ancien de l’UE à la solution à deux Etats entre Israël et la Palestine.
Cependant, la République tchèque choisissait une troublante abstention, soit une autre forme de désaveu du consensus européen à ce sujet. En revanche, la Slovénie, qui avait reconnu la Palestine depuis plus d’un an, devenait, le 25 septembre, le premier Etat de l’UE à interdire son territoire à Benyamin Nétanyahou, le premier ministre israélien.
Des dirigeants tchèques historiquement favorables au sionisme
Le « père fondateur » de la République tchécoslovaque, Tomas Masaryk, qui en fut le président de 1918 à 1935, était très proche des milieux sionistes. Il fut d’ailleurs le premier chef d’Etat à se rendre, en 1927, en Palestine, alors sous mandat britannique. Au cours de ce séjour, il tint à visiter la toute jeune université hébraïque de Jérusalem et le grand rabbin Abraham Kook, qui avait « béni » le Royaume-Uni pour avoir été l’« instrument de Dieu dans l’accomplissement de Sa promesse », soit le « retour du peuple juif sur la terre d’Israël ».
Masaryk alla aussi à Tel-Aviv, fondée en municipalité juive deux décennies plus tôt, ainsi qu’à Haïfa et dans plusieurs kibboutz. Le soutien du premier président tchécoslovaque au projet sioniste était tel que, après sa mort, en 1937, un kibboutz du sud d’Acre fut appelé Kfar Masaryk, soit « village de Masaryk ». Et l’engagement de la Tchécoslovaquie ne se démentit pas, même après la prise de pouvoir par les communistes, en 1948, puisque Prague livra à l’Etat d’Israël, à peine fondé, des armements déterminants pour sa victoire face aux Etats arabes coalisés.
Il vous reste 58.44% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.