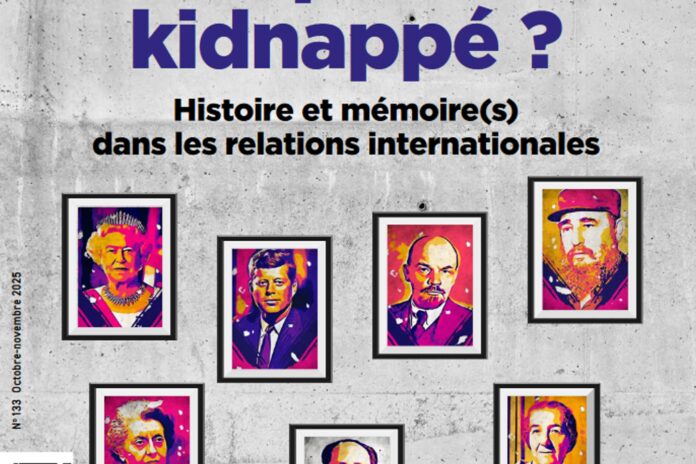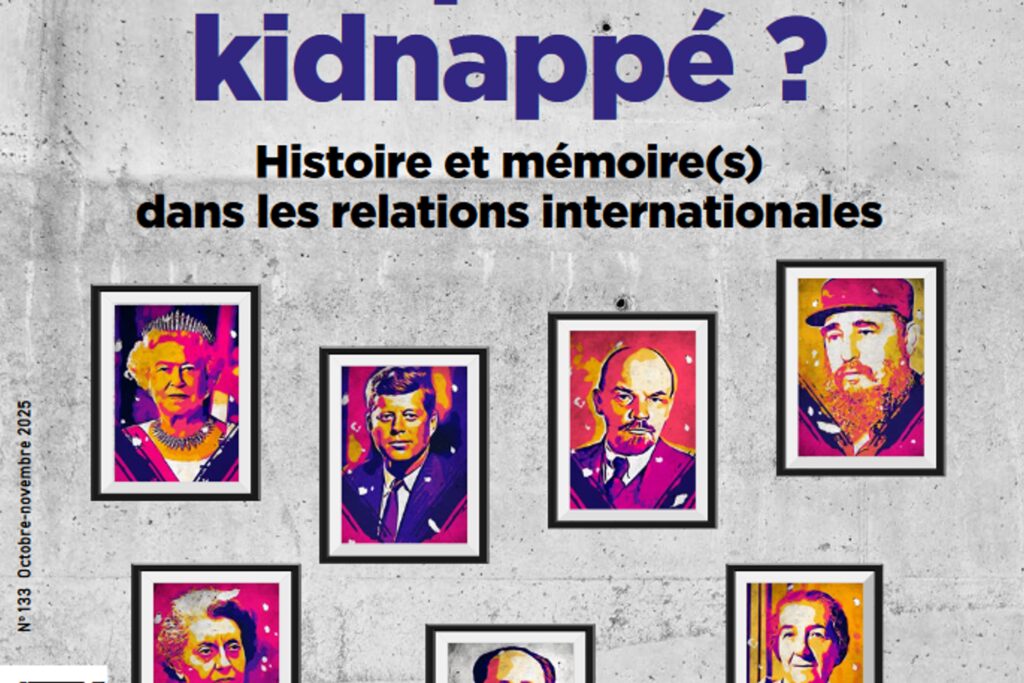
La revue des revues. Voici un numéro qui tombe à pic, au regard de l’actualité tant hexagonale qu’internationale. Celle-ci est saturée par les revendications mémorielles, qui apparaissent comme autant de rappels impuissants aux règlements, alors que les entorses au droit international, au respect des personnes, voire aux valeurs démocratiques sont de plus en plus nombreuses. Après la panthéonisation du résistant apatride Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, et avant celle de l’historien Marc Bloch, celle, le 9 octobre, de l’avocat Robert Badinter, qui a réussi à convaincre l’opinion publique et les représentants de la nation du bien-fondé de l’abolition de la peine de mort, montre l’importance du devoir de mémoire. Mais celui-ci oscille entre deux écueils : la sacralisation et la banalisation.
Dans un excellent article du n° 133 de la revue Questions internationales, « Le passé kidnappé ? Histoire et mémoire(s) dans les relations internationales », l’historien Patrick Garcia rappelle en effet à quel point la commémoration reste un instrument politique, au service d’un récit national. Avec six entrées prévues en huit ans, en comptant celle, en juin 2026, de l’auteur de L’Etrange défaite (Franc-Tireur, 1946), Emmanuel Macron sera le chef de l’Etat qui a panthéonisé le plus de personnalités durant ses deux mandats.
Cette inflation commémorative ne vaut pas adhésion de la nation et ne se traduit pas par une plus grande envie de « faire société » entre concitoyens. Bien au contraire. La dégradation de la tombe de l’artisan de la dépénalisation de l’homosexualité en 1982, quelques heures avant son entrée au Panthéon, traduit ces rancœurs hexagonales.
Passé otage du présent
Sur le plan international, l’historien Alexandre Sumpf montre comment la réécriture de l’histoire est devenue une arme de guerre utilisée par Vladimir Poutine, tant dans ses relations avec les pays d’Europe centrale, qu’avec les Républiques caucasiennes ou celles d’Asie centrale. D’un côté, le nouveau « tsar » a exalté le rôle glorieux des Russes pendant la seconde guerre mondiale, pour renforcer la cohésion en interne. De l’autre, il s’est lancé dans une opération de vassalisation de ses voisins, suscitant en retour un nationalisme antirusse commun en Ukraine comme en Pologne, ou dans les Etats baltes.
Il vous reste 26.86% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.